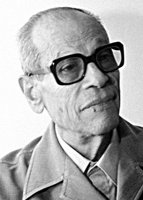Les clés du Moyen-Orient
Par Chakib Ararou
Article publié le 21/06/2018
Mahfouz au temps des officiers
Lorsque le coup d’état des Officiers libres éclate en juillet 1952 en Egypte, le romancier Naguib Mahfouz (1911-2006) vient d’achever l’écriture de sa trilogie cairote, qui couvre toute l’histoire de l’Égypte de la Première à la Seconde Guerre mondiale. Cette œuvre qui écrase tout le reste de la production de son auteur, pourtant foisonnante et multiple, pour une grande partie du public européen, ne sera publiée que quelques années plus tard, en 1956. Elle est en vérité, à la charnière de l’œuvre mahfouzienne, une ligne de partage entre deux moments structurants : l’époque des grands romans réalistes comme Zuqâq al-Midaq (Passage des miracles en traduction française) et celle, plus cryptée, des romans dont il sera ici question. Œuvre de la reconnaissance, puisque Mahfouz obtiendra grâce à elle le Prix de l’Etat égyptien pour la littérature 1958, cette trilogie écrite avant Nasser obombre néanmoins la singulière attitude de l’écrivain face au nouveau régime : d’abord le silence, de 1952 à 1959, où Mahfouz vit de scénarios de films et publie finalement le grand-œuvre longuement resté dans ses tiroirs ; ensuite, le développement d’une esthétique allusive qui donne lieu à l’une des périodes les plus riches de son œuvre. Une promenade s’impose donc parmi les romans du Mahfouz « symbolique » ou « philosophique », selon les termes un peu convenus de la critique, dont on espère ressortir avec quelques clés de déchiffrement.
Au commencement, la crise d’Awlâd Hâratinâ
En 1959, Les Fils de la Médina (Awlad Hâratinâ) fait suite à la trilogie avec l’ambition de refaire le récit des grands prophètes Adam, Moïse, Jésus et Mohammed, rhabillés pour l’occasion en figures de proue du petit peuple cairote. Tous sont soumis à la tyrannie de Gabalawi, deus absconditus local qui allie en virtuose l’emprise à l’absence. L’allégorie religieuse est audacieuse, mais la méditation sur le pouvoir, ses abus et ses écueils brille peut-être encore plus, Mahfouz peignant à demi-mot le méchant visage de l’autoritarisme policier sous couvert de frasques commises par ces bandits de quartiers, les futuwwa, qui faisaient la loi dans le vieux Caire du début du XXe siècle. Érigés en figures intemporelles, quasi-mythologiques, ils frustrent dans le roman les élans messianiques successifs des prophètes-héritiers de Gabalawi, et ramènent sans arrêt la hâra, cette ruelle typique du Caire islamique dont Mahfouz fera plus d’une fois le pli où se logent les problèmes universels, à une réalité toute d’argent et de sang. Lorsque le roman paraît en feuilleton dans le quotidien Al-Ahram, la censure religieuse sévit. Le pouvoir nassérien ménage l’auteur, laisse la publication s’achever dans la presse, mais le volume ne suivra pas. L’ouvrage finit par être publié en volume sous d’autres latitudes, à Beyrouth, en 1967. La traduction française de Jean-Patrick Guillaume, parue en 1991, donnera à la France le roman in extenso bien avant l’Égypte, où l’édition ne se fait qu’après la mort de Mahfouz en 2006. Quant à la polémique, elle aura la vie dure et connaîtra un rebondissement tardif d’une singulière violence : c’est à cet ouvrage que se référeront, en 1994, les deux membres de l’organisation islamiste Al-Gamâ‘a al-Islamiyya qui tenteront d’assassiner Mahfouz. Notre auteur s’en trouvera rhabillé à vie en écrivain-martyr officiel, consacré, révéré et utilisé politiquement, lors même que les séquelles de son agression lui rendent désormais l’écriture presque impossible (1).
Au milieu du gué
Les romans qui suivent la crise d’Awlad Haratina méritent toute notre attention : ils poursuivent la réflexion mahfouzienne sur l’autorité en troquant le temps mythique pour une écriture qui ne ressemble en rien à son ancienne manière. Plus trace, dans Le Voleur et les chiens (al-Liss wal-Kilâb, 1961), La Quête (al-Tarîq, 1964) ou Le Mendiant (al-Shahhâdh, 1965), des longs tableaux d’ambiance hérités du roman du XIXe siècle européen qui rythmaient la Trilogie : le cadre est planté en quelques notations sommaires dans tel recoin de la géographie du Caire, avec çà et là une excursion alexandrine. Le temps ? Le présent problématique d’après 1952, sans plus de détails. L’essentiel se joue dans le dépouillement progressif d’un protagoniste immédiatement campé au milieu d’un gué où il ne saurait longtemps se tenir. Quand il n’est pas familier de milieux pauvres ou interlopes, comme Saïd Mahrane dans Le Voleur et les chiens ou le Sâbir de La Quête, il y vient de lui-même comme l’avocat Omar al Hamzawi dans Le Mendiant ou l’inoubliable Anis Zakî de Dérives sur le Nil (Tharthara fawq al-Nîl, 1966), qui troque son habit de fonctionnaire pour la pipe de kif d’une péniche nilote. Chacun de ces personnages se trouve confronté à un inachèvement inacceptable. Celui des seules promesses bafouées du socialisme nassérien d’alors ? Non point. Chaque récit est habité par la question, certes, mais Mahfouz ne campe pas des types abstraits : ses personnages complexes dépassent en envergure la fonction testimoniale dans laquelle on voudrait trop vite les enfermer. L’avocat Al-Hamzâwi, dans Le Mendiant, est d’abord saisi par la nostalgie d’une vocation poétique abandonnée, Sâbir, le fils de la prostituée de La Quête, perd avec sa mère une rente et des repères. Il apprend que son père, qu’il croyait mort et n’a jamais connu, vit bien quelque part dans le vaste monde avec sa fortune. Le voleur Mahrane rumine son échec à transformer ses idéaux en action viable et sa relation amoureuse, dont une fille est issue, en véritable famille. Tous ces romans sont des quêtes avortées (de quoi ? « la liberté, l’honneur et la paix », avoue du bout des lèvres Sâbir dans une sorte de scorie à l’intérieur d’un dialogue), en même temps que d’implacables constats d’échec.
Deux récits des marges
À l’intérieur de ce cycle se dessine un premier tandem romanesque, celui du Voleur et de La Quête, où un personnage se débat entre l’appel du sang et celui d’une vie enfin normale ou simplement normée. Sorti de prison, Saïd Mahrane cherche à récupérer sa fille. Il sollicite le journaliste Raouf Elouane, autrefois son mentor en marxisme qui sut le pousser vers une désastreuse carrière de Robin des Bois achevée, comme de juste, derrière les barreaux. Pendant ce temps, Elouane a réordonné sa charité, réussi dans la presse et tiré un trait sur sa verve militante une fois pour toute. Mahrane sort de prison. Sa fille l’évite, le journaliste et maître à penser d’autrefois le méprise, et voilà Saïd rendu à un dénuement qui le laisse en proie à la rancune et à la tentation du meurtre qui seul semble pouvoir la soulager. Le Sâbir de La Quête, lui, part à la recherche d’un père dont sa mère agonisante ne lui a donné que le nom comme promesse d’une fortune encore possible : le garçon, sans qualification ni expérience, n’a pas d’autre espoir pour survivre. À la recherche du père, il rencontre une jeune journaliste qui s’éprend de lui et s’évertue à lui proposer une vie de confort relatif et de stabilité. Mais c’est sans compter sur la (trop) jeune épouse du logeur de sa pension, un vieillard qu’elle veut faire assassiner pour vivre de son héritage. Sâbir entame une liaison avec cette dernière, et finit par choisir son parti. Autour de ces deux apologues sociaux se construit par touches un climat d’une extrême pesanteur, que figure une galerie de personnages secondaires hauts en couleur. Magnifiquement campé par le grand Hassan Al Baroudi dans l’adaptation cinématographique de Hosâm al-Dîn Mustafâ, le logeur sénile de la pension de La Quête, grippe-sous et libidineux, figure cette vieille garde omniprésente qui, en dépit de la rhétorique jeuniste du régime, freine plus que jamais les forces vives de l’Égypte. Quant aux incarnations, généralement féminines, du monde tel qu’il va, elles ne parviennent pas à convaincre. Il n’est pas surprenant que la plus attachante d’entre elles, la prostituée Nour (« Lumière ») du Voleur, soit celle qui offre un refuge et une empathie sans condition au voleur déjà perdu. Sans aucune emphase, dans un patient crayonnage tout en nuances de gris, Mahfouz fait ressortir la veulerie étouffante d’une société où n’est tenue aucune des promesses bruyamment claironnées par ses nouveaux maîtres.
Vers le mutisme et retour
Saïd Mahrane et Sâbir al-Rahimi subissaient le dénuement et cherchaient à venger trahisons et abandons. Symétriquement, Omar al-Hamzâwi et Anis Zakî, qui ont tous les deux ce qu’il est convenu de nommer une situation, s’en défont pour chercher leur salut dans une forme de dénuement volontaire. Le premier, dans Le Mendiant, s’autoproclame malade et cherche partout remède à l’apathie qui le ronge. Il se débarrasse tour à tour de sa famille, de son travail, de ses aventures sexuelles qui ne lui apportent rien et pour finir de toute relation humaine afin de trouver une réponse à cette même quête de sens. On la voit, au fil du roman, se déplacer du politique au poétique, puis du poétique au métaphysique, la réalité rattrapant brutalement et en vain l’ancien avocat reclus dans la campagne égyptienne où il se terre en silence, tout à sa contemplation de la nature et à ses rêves hallucinés. Dans Dérives sur le Nil, comme le souligne un admirable article (2), le fonctionnaire Anis Zakî se distingue de la foule de causeurs qui l’environne, chevaux de retour repus de l’époque, en poussant son doute méthodique jusqu’à l’idée même de sens. Sans autre interlocuteur que le haschisch, il ne trouve d’obstacle à son acquiescement apathique à ce qui est que dans l’interdit fondamental du meurtre. Toute l’équipe de la péniche l’avait transgressé, sans le vouloir mais sans remords non plus, en fonçant en voiture sur un paysan. Devant le déni général, il finit par réclamer justice. Le livre s’interrompt brutalement sur la plongée d’Anis dans la torpeur causée par un somnifère qu’on a mélangé à son café, cependant qu’il sent que « d’ici peu, la tête de la baleine viendra fendre la surface de l’eau. » Moderne Jonas, donc, tiraillé entre sa lassitude de la vie sociale et son refus de s’affirmer investi d’un message, il incarne mieux que tout autre un scepticisme blanc (distinct du noir à la manière dont diffèrent magies blanche et noire). Nulle trace chez Anis Zakî du ressentiment et de l’impatiente d’en découdre : son geste révolutionnaire est d’un genre plus furtif. À la manière du Bartelby de Melville, il refuse simplement de servir et revendique son doute, auquel il ne pose d’autre limite que le refus de la violence absurde et gratuite. Le Mendiant raconte donc la lente dégradation de son protagoniste vers l’aphasie face aux désillusions successives ; Dérives en pose les limites en peignant le retour de conscience tardif – peut être dérisoire ? – du sien.
Du voleur de 1961 au « Prométhée drogué » de 1966 s’opère une lente progression dans l’œuvre de Mahfouz : la première esquisse, celle du Voleur, est celle d’une victime contrainte à répondre aux coups par les coups ; le dessin achevé de Dérives offre le beau portrait d’un homme à la lucidité seconde, au propre des volutes de cannabis comme au figuré du pas de côté. Pour inféconde qu’elle paraisse (a-t-on jamais demandé au romancier des solutions ?), la révolte d’Anis Zakî ronge de l’acide de sa critique tous les préjugés qui rassurent les hommes au milieu du gué, en troquant toute arrogance analytique pour le dit évasif et éloquent du mythe. Dans l’adaptation cinématographique du roman, tournée en pleine purge du nassérisme en 1971, on fait visiter à Anis Zakî les ruines de Suez pour le ramener à la conscience morale et politique et l’envoyer haranguer la rue cairote, l’exhortant à se réveiller à sa suite tandis que la péniche des débauchés lèvre l’ancre et part à la dérive… Cette fin édifiante, parfait contrepied du livre, remet les bons et les mauvais de part et d’autre de la corniche. Pour qui ne s’en satisferait pas, il ne reste qu’à revenir au texte qui affronte les vérités toutes équivoques qui, toujours, courent par temps incertains…
Notes :
(1) Voir Hosam Abou-Ela, “The Writer Becomes Text : Naguib Mahfouz and State Nationalism in Egypt”, dans Biography vol. 27 n°2, University of Hawai’i Press, printemps 2014, pp. 339-356.
(2) http://www.almasryalyoum.com/news/details/355637
Les Fils de la Médina (Awlâd Haratina), 1959, traduit par Jean-Patrick Guillaume, Actes Sud Babel n°611.
Le Voleur et les chiens (al-Liss wal Kilâb), 1961, traduit par Khaled Osman, Actes Sud Babel n°209.
La Quête (Al-Tarîq), 1964, traduit par France Meyer, Denoël/Folio Gallimard n°3258.
Le Mendiant (al-Shahhâdh), 1965, traduit par Mohamed Chairet, Actes Sud Babel n°522.
Dérives sur le Nil (Tharthara fawq al-Nîl), 1966, traduit par France Meyer, Denoël/Folio Gallimard n°2311.
Lire l’article sur le site Les clés du Moyen-Orient
A propos des clés du Moyen-Orient
Les clés du Moyen-Orient propose aux internautes des informations et des expertises scientifiques, rigoureuses et en temps réel sur l’Histoire et l’actualité du Moyen-Orient.